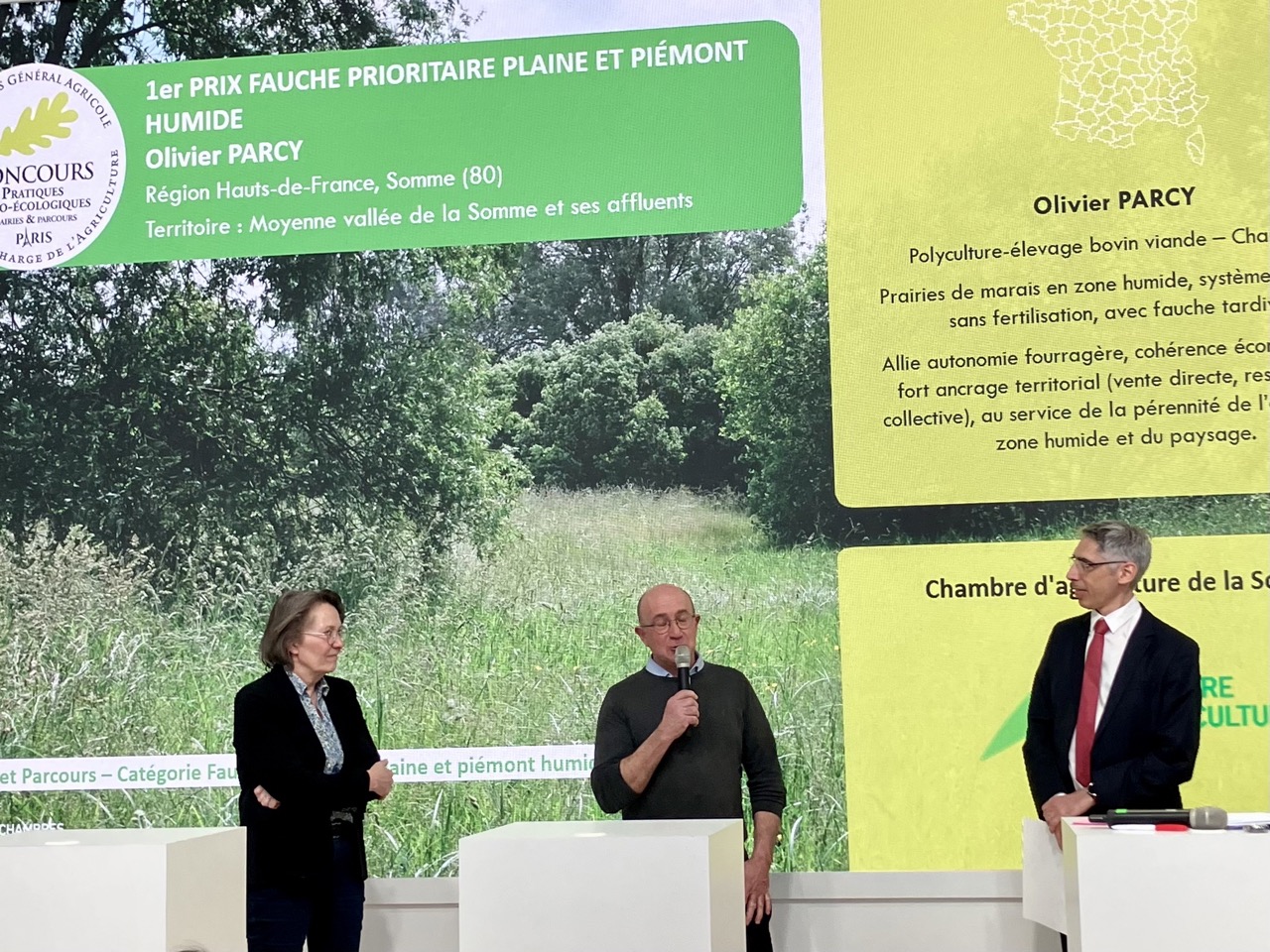Betteraves
La Somme dans une situation « intermédiaire » face à la menace de jaunisse
La situation jaunisse a évolué au cours du mois de juillet. Malgré une année très favorable à la productivité, grâce à des semis précoces et des conditions climatiques idéales, la jaunisse est aujourd’hui le principal facteur limitant du rendement des betteraves dans les zones touchées. Le point avec l’Institut technique de la betterave (ITB).
La situation jaunisse a évolué au cours du mois de juillet. Malgré une année très favorable à la productivité, grâce à des semis précoces et des conditions climatiques idéales, la jaunisse est aujourd’hui le principal facteur limitant du rendement des betteraves dans les zones touchées. Le point avec l’Institut technique de la betterave (ITB).

Le Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne et la Seine-Maritime sont relativement épargnés par la jaunisse en 2025. Les symptômes ne dépassent pas 5 % de la surface des parcelles les plus touchées, se manifestant généralement par quelques betteraves isolées ou des foyers très limités, sans impact sur la productivité. En revanche, l’Ile-de-France est le département le plus affecté, avec 20 % de parcelles présentant des symptômes sur plus d’un quart de leur surface. Viennent ensuite la Champagne et le Centre-Val-de-Loire avec 10 % de parcelles touchées dans les mêmes proportions. L’Eure, l’Oise et la Somme se situent dans une situation intermédiaire.
Facteurs agronomiques qui ont favorisé la présence de jaunisse
Les pucerons présents du 10 avril au 15 mai ont été bien maitrisés par les aphicides. Ils étaient omniprésents pendant toute la période, mais leur abondance modérée a pu être contenue. Toutefois, une recrudescence importante a été observée fin mai et début juin, à une période où les betteraves n’avaient pas toutes atteint le niveau de maturité qui freine la transmission virale. Les betteraves les plus âgées à ce moment-là, avec une couverture du sol quasi complète, ont bien résisté. En revanche, les parcelles pour lesquelles la couverture foliaire était encore incomplète au 1er juin sont aujourd’hui les plus touchées, même si des traitements aphicides ont été réalisés pendant le pic de vol. Plusieurs causes sont identifiées : semis plus tardif en avril, stress hydrique à l’implantation ayant freiné le développement, dégâts de limaces ou de tipules entrainant la perte de plantes, ou encore zones moins poussantes comme les buttes de craie. L’hétérogénéité d’une parcelle est un facteur aggravant, les pucerons étant attirés par des contrastes visuels et olfactifs. Ce phénomène avait déjà été mis en évidence en 2019, à la suite d’un épisode de gel au printemps. Autre observation qui se répète chaque année : selon le sens du vent, les zones abritées par des haies ou des bois sont également favorables à la présence de pucerons et de symptômes. Elles constituent en revanche un rempart physique pour freiner les vols de pucerons au sein d’un paysage.
Le BYV fortement présent dans les premières analyses virales
Les premiers tests virologiques réalisés en juillet par l’ITB révèlent une forte présence du virus de la jaunisse grave BYV, détecté dans 80 % des parcelles symptomatiques. Les polerovirus sont en revanche beaucoup moins fréquents cette année, présents dans seulement 30 % des parcelles (contre 60 à 95 % les années antérieures). Ces résultats confirment l’hypothèse d’une contamination majoritairement survenue lors du pic de vol des pucerons fin mai et début juin. En effet, la transmission virale du BYV reste possible pour des betteraves à un stade proche de la couverture, alors qu’elle est quasiment nulle pour les polerovirus. La forte présence de pucerons noirs, vecteurs spécifiques du BYV, a également contribué à la dynamique épidémiologique, même si le taux de transmission est plus faible qu’avec le puceron vert du pêcher.